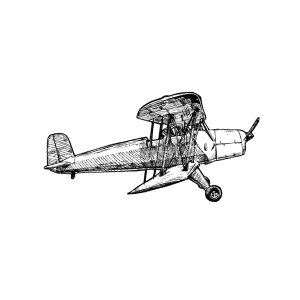Newsletter
FOOD FOR THOUGHT
Food for Thought
Quand le feedback donne du sens
Au fil des dernières années, en travaillant avec des apprenants, j’ai remarqué que le feedback ne vient pas naturellement à tout le monde. Et lorsqu’il vient, il n’est pas toujours formulé de manière constructive. Donner du feedback demande du soin ; notamment un ton approprié et une intention claire de faire évoluer plutôt que de corriger. Lorsque le message est congruent et entendable, c’est presque magique : il est pris en compte et respecté. La communication circule, la confiance se construit, l’apprentissage s’enclenche.
Alors, pourquoi est-ce si difficile ?
Parce qu’il touche à l’humain.
Donner un feedback, c’est oser un moment d’inconfort ; recevoir un feedback, c’est accepter une part de vulnérabilité. Bien souvent, le message n’est pas entendu :
trop direct, mal formulé, ou encore trop flou pour être utile. L’article “The Essential Role of Feedback in Effective Communication” de FasterCapital le rappelle : une communication efficace repose sur des boucles de feedback. Autrement dit, une conversation où l’information circule et s’ajuste — pas une simple transmission à sens unique. Le feedback n’est pas une flèche lancée ; c’est une boucle vivante entre deux personnes. Pour que cette boucle fonctionne, il faut un ingrédient essentiel : le sens.
C’est ce que souligne l’article “Why Feedback Can Make Work More Meaningful” de la Harvard Business Review : le feedback ne sert pas seulement à améliorer la performance — il rend le travail plus significatif. En d’autres termes, un feedback bien formulé ne dit pas seulement « voici ce que tu dois changer » — il dit aussi « voici pourquoi ce que tu fais a de la valeur ».
Et c’est cette reconnaissance-là qui transforme le feedback en motivation et en apprentissage.
D’ailleurs, d’où vient le mot “feedback” ?
Le mot “feedback” vient du monde de l’ingénierie et de la cybernétique, dans les années 1940.
Il décrivait alors un mécanisme de rétroaction : le signal de sortie d’un système qui revient à son entrée pour corriger ou stabiliser le fonctionnement. C’est le principe du gouvernail qui permet de prendre, au fur et à mesure par rétroaction, la bonne direction.
Puis la notion a migré vers la communication, la pédagogie et le management.
Aujourd’hui, le feedback garde cette essence technique — observer, corriger, améliorer — mais il s’est enrichi d’une dimension humaine : écouter, comprendre, grandir.
C’est cette alchimie entre rigueur et bienveillance qui en fait un outil aussi puissant… et aussi délicat à manier.
Le feedback, c’est plus qu’une technique.
C’est un acte de lien : entre deux personnes, entre l’action et le sens, entre le progrès et la reconnaissance.
Quand il est bien formulé, il devient un moteur d’apprentissage, de communication et de transformation.
Sources :
Food for Thought
L’IA, opportunité ou menace ?
Depuis le début de notre histoire, dans le cadre de nos réflexions sur l’apprendre à apprendre, il y a une réflexion centrale sur le rôle des outils et de la technologie, en lien avec ceux de l’apprenant et du facilitateur. L’analogie de l’orchestre reste entière : Quelle est la valeur ajoutée d’un chef d’orchestre (facilitateur) ? Qu’est-ce qu’un musicien (apprenant) peut et ne peut pas faire seul avec la variété d’instruments (outils et technologies) et de partitions (contenu) à sa disposition ? Comment intégrer de nouveaux instruments (outils et technologies) dans l’orchestre ? Lorsque la télévision est arrivée certains pensaient que la radio allait disparaître, et nos bons vœux livres ont toujours une place de choix… Le développement des potentialités de l’IA offre de nouvelles perspectives et nous amène à réfléchir et à réajuster perpétuellement, à l’échelle de nos organisations comme à celle de nos sociétés, l’équilibre au sein de l’orchestre.
Nous savons que nous allons pouvoir confier à l’IA de nombreuses tâches chronophages, ce qui est à la fois selon moi une opportunité et une menace.
L’IA peut nous offrir indirectement l’opportunité de développer notre intelligence émotionnelle et intuitive. Rappelons-nous que la fin de l’hégémonie d’une vision restreinte de l’intelligence, celle qui nous permet de répondre haut la main aux tests de QI – ou pas 😉- n’est que très récente. Howard Gardner, professeur de psychologie américain concepteur de la théorie des intelligences multiples, est l’un des 1ers à l’avoir remise en cause… nous étions dans les années 80 ! Il identifie alors parmi les différentes formes d’intelligence deux formes d’intelligences « personnelles » directement liées à la compréhension de la nature humaine, l’intelligence interpersonnelle et l’intelligence intrapersonnelle. Il estime par ailleurs que ces aptitudes sont essentielles pour trouver son épanouissement et son chemin de vie…
Cette théorie donnera naissance au courant de « l’intelligence émotionnelle ». C’est le psychologue et journaliste scientifique américain Daniel Goleman qui popularise cette notion, avec son best-seller mondial L’Intelligence Emotionnelle. L’un de ses messages clés est que nos émotions nous guident vers la bonne décision, et plus rapidement que l’esprit rationnel, pour peu qu’on les laisse s’exprimer sans les laisser nous envahir.
Dans la lignée de l’intelligence émotionnelle, l’intuition, thème de recherche des neurosciences, est la marque de l’intelligence de notre inconscient et recoupe plusieurs aptitudes, d’une part des aptitudes liées à la conscience de soi et d’autre part des aptitudes liées à la conscience des autres…les clés de voûte du Miroir de mon modèle MMAPPER.
J’ai eu il y a quelques années le privilège de rencontrer Stephen Karpman psychiatre américain héritier d’Eric Berne rendu célèbre pour son triangle dramatique. En petit comité dans nos bureaux parisiens, j’ai eu ce soir-là la chance de découvrir l’extra-ordinaire potentiel de ma propre intelligence intuitive…
La menace principale selon moi est de ne plus savoir faire le cheminement d’apprentissage logico-déductif qui nous permet de savoir faire tant de choses aujourd’hui. Ceci pourrait nous amener à moins stimuler notre QI et ainsi devenir dépendants de la technologie. Aussi, nous savons que pour qu’un projet ait de la valeur il faut qu’il y ait eu un chemin. Cette menace est notamment évoquée dans la docusérie AI at Work de Samuel Durand.
Pour conclure selon moi nos défis de demain en lien avec le développement de l’IA sont multiples :
- Faire l’effort de prendre régulièrement de la hauteur afin de définir la juste place de l’homme & de la machine
- Oser développer notre intelligence émotionnelle et intuitive
- Continuer à cultiver notre QI.
Je suis aujourd’hui inquiet de constater que nombre de collectifs continuent de se surfocaliser sur la productivité et sont aussi en perdition sur la communication…
Je continue pourtant de croire dans le potentiel de l’homme et de l’intelligence collective – qui j’ose espérer demeurera toujours plus puissante que l’IA – et poursuit mes accompagnements d’équipe avec la même passion qu’au 1er jour.
Cultivons la relation entre les Hommes plutôt que les connexions entre l’Homme et la Machine.
Food for Thought
Le CARPE DIEM au travail est-il recommandable ?
Le CARPE DIEM est l’un des concepts-clés du pilier Plaisir de MMAPPER. Un concept qui laisse rarement nos apprenants indifférents, fait briller les yeux de certains, en laisse d’autres sceptiques. Un concept qui pour beaucoup n’aurait pas sa place dans le monde du travail… Comme il n’avait à priori sa place entre les murs de la prestigieuse académie de Welton du « Cercle des poètes disparus », l’une des références d’ImpaQt en termes de philosophie pédagogique.
CARPE DIEM est un célèbre vers issu des « Odes » du poète romain Horace (23 ou 22 avant J-C).
La formule complète est « Carpe diem, quam minimum credula postero », littéralement « cueille le jour, et [sois] la moins crédule [possible] pour le [jour] suivant. Elle résume le texte qui la précède où le poète cherche à persuader la destinataire, Leuconoé, de profiter du moment présent et d’en tirer toutes les joies possibles, sans s’inquiéter du jour de sa mort.
Les études psychologiques sur le sujet démontrent qu’une approche carpe diem active a deux facettes :
- Se focaliser sur le présent
- Être conscient de la valeur de chaque instant de notre vie, en lien avec la conscience de l’inéluctabilité de notre mort.
Pourtant, cette citation est souvent mal interprétée, et vue comme une invitation à l’hédonisme, à jouir du moment présent et satisfaire des besoins immédiats, sans se poser de questions, peu compatible avec le monde sérieux et raisonnable du travail.
Or au CARPE DIEM d’Horace est associée une notion d’équilibre dans le plaisir que l’on retrouve dans MMAPPER avec la notion de curseur. CARPE DIEM, ce n’est pas « All play & no work » ; c’est apporter des touches de légèreté et de plaisir dans son quotidien, c’est goûter et savourer “the marrow of life” ; par exemple en offrant et en recevant de la gratitude et de la reconnaissance à ses collègues, ou encore en prenant le temps de célébrer et savourer les réussites individuelles et collectives.
C’est aussi et surtout une invitation à modifier notre rapport au temps.
La fameuse traduction anglaise « Seize the day » du Dr Keating nous invite à être acteur de notre existence, oser saisir les opportunités qui s’offrent à nous sans les reporter à demain. En termes MMAPPER, le CARPE DIEM est tant associé au pilier Plaisir qu’au pilier Acteur. Il s’agit de ne pas perdre son temps à ressasser le passé mais d’apprendre de nos erreurs passées, et de ne pas s’inquiéter de l’avenir mais d’agir maintenant pour le construire plutôt que de repousser les choses à plus tard.
Voici quelques exemples d’application dans le monde du travail : décider de se focaliser sur un sujet prioritaire lors d’une réunion où d’habitude tous les sujets sont rapidement passés en revue et les actions reportées à plus tard. Ou encore organiser un moment « off » de connexion avec les membres de l’équipe plutôt que de se promettre de le faire une fois que l’équipe aura moins la tête dans le guidon…ce qui n’arrivera probablement jamais. Il ne s’agit pas de ne pas prendre en compte les contraintes de l’organisation et de la réalité de la situation, mais de ne pas subir le système et sans cesse reporter l’important à demain.
C’est ainsi qu’une pratique active du CARPE DIEM individuelle et collective peut permettre à une équipe de s’épanouir et de de relever d’extraordinaires défis.
Souvenons-nous et savourons sans modération la voix énigmatique du Dr Keating murmurant à ses élèves :
« Carpe…carpe…carpe diem….
Seize the day boys
Make your lives extraordinary ! »
Food for Thought
De la diversité à l’inclusion
« Diversity is being invited to the party ; inclusion is being asked to dance. » Verna Myers
Nous avons accompagné au 1er semestre plusieurs équipes dites inclusives – des équipes caractérisées par la diversité, diversifiées en termes de profil de personnalité, genre, âge et culture. Or d’une équipe internationale où près de 10 nationalités sont représentées à une équipe à l’origine franco-française s’ouvrant depuis peu à la diversité, les situations et les vécus des membres de l’équipe peuvent être très différents.
Une étude de janvier 2020 réalisée par le cabinet Deloitte ‘Etude Diversité et Inclusion – Faire de l’inclusion un levier de transformation des organisations’ montre que les entreprises qui pratiquent une politique inclusive génèrent jusqu’à 30% de chiffre d’affaires supplémentaire par salarié et une profitabilité supérieure à celle de leurs concurrents. Selon cette même étude, les entreprises dotées de politiques d’égalité des chances dans l’emploi et de cultures favorisant la mixité ont près de 60 % de chances supplémentaires de voir leur profit augmenter.
Pourtant, tout comme l’empowerment, l’inclusion ne se décrète pas… Et la diversité et l’inclusion en entreprise, comme dans nos sociétés, malgré toutes les meilleures intentions du monde, peuvent se révéler être de véritables pièges lorsqu’elles ne sont pas, ou pas assez, accompagnées.
Au fait c’est quoi l’inclusion ?
L’inclusion est un concept holistique relativement récent. Il s’agit de créer des environnements où toutes les personnes, quelles que soient leurs différences, sont valorisées et respectées. L’inclusion reconnaît que tout le monde a le droit de participer pleinement au collectif sans avoir à se conformer à une norme dominante. L’inclusion va ainsi plus loin que l’intégration qui implique souvent que les personnes doivent s’adapter au système existant, ce qui peut entraîner une perte de leur identité culturelle et la nécessité de changer leurs comportements pour mieux s’intégrer.
Voici une image qui illustre explicitement la différence entre intégration et inclusion :
Quelle est la différence entre intégration et inclusion ? (bloghoptoys.fr)
Comment passer de l’intégration à l’inclusion ?
Pour une équipe dont l’ADN est international, où les membres de l’équipe se définissent comme citoyens du monde et ont une bonne maîtrise de l’anglais, l’inclusion semble aller de soi. La problématique de ces équipes est plus liée à la distance et au manque de contact en face-à-face qu’à celle de l’inclusion. La curiosité et l’envie de découvrir l’autre est là et le regard porté les uns sur les autres est fondamentalement +/+ : « J’ai de la valeur. Tu as de la valeur. Nous pouvons ainsi entrer en relation et coopérer ». Créer les conditions pour que les membres de l’équipe puissent se connecter humainement reste nécessaire et peut s’avérer suffisant.
La situation est bien différente lorsque l’on a affaire à une équipe où il existe une culture dominante. Pour passer de l’intégration à l’inclusion, un accompagnement dans la durée est requis. Il nous semble d’abord essentiel de s’assurer que les nouveaux membres de l’équipe lorsqu’ils sont étrangers aient une bonne maîtrise de la langue d’usage de l’équipe et donc de les accompagner lorsque ce n’est pas le cas vers un niveau d’opérationnalité dès le début de leur intégration, voire idéalement en amont.
De plus, et surtout dans le cas d’une intégration de nouveaux profils choisie par le top management, tout le monde n’a pas à priori envie de danser, et encore moins avec « n’importe qui ». Comment faire alors pour que chacun trouve le goût et l’envie de « danser » ensemble ? Il n’y a malheureusement pas de recette miracle et le cheminement peut être plus ou moins long. Il s’agit d’amener chacun à oser se regarder dans le miroir, apprécier ses côtés lumineux et accepter ses côtés sombres et biais cognitifs/préjugés associés, puis peu à peu reconnaitre l’autre comme quelqu’un qui est à la fois différent de soi et qui reflète quelque chose de soi, de son humanité ; quelqu’un que l’on reconnait, auquel on peut offrir un sourire authentique et auquel ouvrir la porte à l’idée de pouvoir un jour « danser » ensemble…
Food for Thought
Comment prévenir le burn-out ?
Comment prévenir le burn-out ?
Des personnes aux portes du burn-out, nous en rencontrons parfois dans le cadre de nos accompagnements. Or la plupart du temps ni la personne elle-même ni son entourage professionnel n’en ont réellement conscience…
J’ai une anecdote poignante à ce sujet :
Celle de cet homme qui lors d’un acte de développement déclare : « Je serais prêt à tout sacrifier pour mon travail ». Je me souviens encore de l’expression de son visage lorsque ses mots lui ont été restitués…
Au fait, c’est quoi le burn-out ?
Le burn-out, syndrome d’épuisement physique et psychique, est le stade final d’un stress chronique lié au travail… qui n’a pas été géré à temps. Il est caractéristique des personnes de nature engagée et/ou perfectionniste. Car comme le dit souvent Richard, nous avons tous les défauts de nos qualités…
Les causes d’un burn-out sont selon moi à la fois internes ET externes. Elles sont à la fois liées aux failles d’un individu ET à des excès dans la demande collective. Et de la même façon les solutions durables ne peuvent être, à mon sens, qu’individuelles et collectives.
Les prémices d’un burn-out se manifestent de la façon suivante : lorsque le TRES devient TROP et/ou le PEU devient PAS ASSEZ : trop de charge, trop de pression, trop de plans d’action, trop de trop… et pas assez de temps, pas assez de priorisation, pas assez de soutien, trop de pas assez…
Quelles sont les clés de la prévention du burn-out ?
La première clé de la prévention du burn-out est selon moi une bonne connaissance de nous-même, de nos besoins et de nos signaux d’alerte, ces comportements subtils – comme par exemple des difficultés à déléguer ou une tendance à ne voir que ce qui ne va pas – qui peuvent, lorsqu’ils deviennent durables et intenses, nous conduire peu à peu au burn-out lorsque nous sommes dans un environnement professionnel (trop) exigeant.
La seconde est la construction de collectifs, d’équipes bienveillantes où les individus se connaissent bien et sont attentifs les uns aux autres. Ainsi, lorsqu’un membre du collectif est en difficulté, le collectif peut proposer du soutien, ce qui sera d’autant plus facile si un esprit et des pratiques de co-développement sont instaurées.
Et comment MMAPPER peut-il contribuer à la prévention du burn-out ?
En tant qu’outil de positionnement individuel, MMAPPER permet à un individu de visualiser le fait qu’il ne soit plus en équilibre, voire en danger de rupture lorsqu’il/elle se positionne à l’une ou l’autre des extrémités – du côté du TROP ou du PAS ASSEZ sur le curseur. Et lorsqu’il a été approprié en tant qu’outil de développement personnel et professionnel, MMAPPER permet ensuite à la personne de définir des objectifs pertinents et mettre en œuvre des actions concrètes, avec si besoin le soutien du collectif.
Géraldine Berruto
Food for Thought
Comment écouter ?
C’est une question que nous avons commencé à poser au tout début de notre histoire, d’abord dans le domaine de l’apprentissage linguistique, et que nous continuons à poser aujourd’hui dans le cadre de nos accompagnements en communication et management. Car l’écoute, reconnue comme une attitude humaine et managériale essentielle, demeure quelque peu mystérieuse.
En 2003, ImpaQt crée un CD-Rom ‘Learning to Listen’ dont l’objectif est le développement de ce que nous appelons alors les stratégies d’écoute (listening strategies). Avec cet outil interactif, les apprenants expérimentent des techniques pour développer leur oreille, leur capacité à entendre, condition essentielle d’une bonne écoute. Ils découvrent également que l’écoute ne se réduit pas à l’écoute des mots mais implique la perception du rythme et de l’intonation de la voix et de l’observation du non-verbal – gestes, posture, expression du visage… Un outil déstabilisant à premier abord pour bon nombre d’apprenants, une révélation dans un second temps pour la plupart permettant d’accéder au message global de cet « autre » qui parle une langue étrangère.
Notre approche de l’écoute était déjà une approche centrée sur la personne, en phase avec celle du célèbre psychologue américain Carl Rogers, personnage marquant du courant de la psychologie humaniste. Rogers croyait comme nous au potentiel de l’homme et parlait de « tendance actualisante », une tendance innée à tendre vers le développement de son potentiel, tel une petite graine… L’écoute, le fait de se sentir entendu, était selon lui l’une des conditions nécessaires à sa croissance et sa maturation.
De par nos conditionnements éducatifs, lorsque nous écoutons, notre attention est souvent portée sur la compréhension des mots de l’autre, au lieu d’être portée sur l’autre, et de ce fait nous ne sommes pas véritablement disponibles à l’écoute de l’autre et de ce qu’il vit.
Comme l’explique Jean-Marc Randin dans son article « Qu’est-ce que l’écoute ? Des exigences d’une si puissante petite chose » « l’écoute est réceptive et non émissive. (…) il faut faire silence dans sa pensée si l’on veut écouter l’autre de manière à l’entendre ». Et c’est la raison pour laquelle je n’aime ni le terme d’écoute active ni celui d’écoute empathique. L’écoute de l’autre permettant à l’autre de se sentir entendu requiert une attitude d’ouverture et de disponibilité dénuée de toute intention, qu’elle soit de comprendre ou d’aider l’autre.
Ecouter demande d’être là pour l’autre et de trouver cette « juste proximité » avec l’autre, lui permettant de se sentir écouté et entendu, et lui laissant suffisamment de place pour qu’il fasse son propre chemin et résolve ses difficultés par lui-même.
L’écoute n’est pas une simple technique ni une méthode que l’on peut apprendre et appliquer à la lettre, et pourtant elle peut s’acquérir pas à pas par le biais de la pratique et en faisant en parallèle un travail sur soi. Car pour être disponible pour l’autre, il est essentiel d’être d’abord disponible à soi, ici et maintenant…
MMAPPER INSIGHT
MMAPPER Insight

Com&Co se transforme
en MMAPPER & Co !
Lorsque j’ai débuté ma carrière, j’ai eu la chance de participer en Angleterre au début des années 90 à un programme de co-développement inspirant intitulé ‘Profit Through People’.
Je rêve depuis de construire un programme similaire, s’inscrivant dans une culture apprenante tout au long de la vie, et différenciant avec le modèle MMAPPER.
A l’aube de mes 65 ans, je crois que je le tiens enfin !
Sa promesse ?
Être capable de :
– se positionner et obtenir une juste image de soi lorsqu’on en ressent le besoin,
– construire un projet de développement concret, des objectifs et un plan d’action associés,
en un mot être acteur de son développement !
Intriguant n’est-ce pas ?
D’ailleurs, à qui s’adresse-t-il ? A tout un chacun ! Ou presque. Le seul pré-requis est d’avoir envie d’apprendre et de grandir.
En effet, le modèle MMAPPER peut s’appliquer à une multitude de problématiques et situations et donner naissance à des projets de développement très variés, en lien avec la réalité et les aspirations de chacun(e).
MMAPPER & Co – The Foundations, ce sera 5 journées de construction des fondations pour découvrir et pouvoir utiliser MMAPPER, construire un projet et savoir comment s’y prendre pour en construire d’autres. Car comme je le dis souvent : que faire lorsque nous n’avons plus de projet ? En construire un nouveau !
Toute personne ayant suivi ce programme pourra ensuite intégrer la communauté apprenante MMAPPER et participer à nos « MMAPPER Days ».
Les différences avec Com&Co ?
– Un programme plus court, plus intense, plus impactant
– Un programme 100% MMAPPER avec un travail de positionnement dans le Miroir avec l’appui d’une variété d’outils (comme PCM, le Triangle de Karpman, l’intelligence émotionnelle et la CNV)
– L’appartenance à une communauté apprenante offrant soutien et stimulation dans la durée
Intrigué(e) ?
Contactez-moi pour en savoir plus.
Besoin ou demande ?
Dans cette période où nous sommes sollicités pour des besoins de développement linguistiques pour l’année à venir, je réalise ô combien souvent que « besoin » est confondu avec « demande ».
Le futur apprenant souhaite améliorer son anglais. Il regarde dans le catalogue et il demande une immersion, ou de l’individuel, ou du e-learning ou encore des cours de conversation… Il coche parmi les choix disponibles. D’accord, c’est la personne qui est à l’origine de la demande, elle est motivée… c’est chouette ! Cela fait déjà 2 ingrédients clés à la réussite d’un apprentissage.
Mais il nous manque quelque chose.
Apprendre pour apprendre ou apprendre pour réaliser un projet ? Nous cherchons dès le début à savoir pourquoi / pourquoi faire avant de réfléchir à la solution. Nos programmes d’accompagnement visent à concrétiser un projet et pas seulement une envie. Le plaisir est bien un pilier de notre modèle MMAPPER et nous le voyons comme une clé de la réussite d’un parcours de développement, mais pas comme le seul point de départ.
J’ai envie de développer mon anglais. OK ✔ Message bien entendu, mais pas encore bien compris. Pour mieux comprendre, nous analysons le besoin en impliquant l’apprenant potentiel, son manager et le service RH. Notre fil d’Ariane, MMAPPER, se prête au jeu et voici quelques exemples de questions que nous posons :
Projet – Qu’avez-vous besoin de faire dans le cadre de votre poste actuel ou futur que vous n’êtes pas capable de faire aujourd’hui ? Dans quel environnement, avec quels interlocuteurs, quelle fréquence, quels enjeux ?
Miroir – Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd’hui ? Quelles compétences linguistiques avez-vous besoin de développer ?
Méthode – Comment est-ce que vous abordez l’apprentissage linguistique ? Quelle(s) approche(s) pédagogiques correspondent le plus à votre niveau de départ, vos styles d’apprentissages, votre délai pour être opérationnel ?
Acteur – Que faites-vous actuellement pour cultiver vos compétences linguistiques ? Que pourriez-vous faire ?
Plaisir – Aimez-vous communiquer en anglais ? Est-ce que suivre une formation vous donne envie ?
Effort – Qu’est-ce qui vous demandera le plus d’effort dans votre apprentissage de l’anglais ? Etes-vous prêt à investir du temps à votre apprentissage en dehors de la formation ?
Risque – Quelles sont les situations de communication qui peuvent être challengeantes pour vous en anglais aujourd’hui ? Osez-vous sortir de votre zone de confort ?
L’évaluation des compétences faite, le besoin analysé et validé avec l’ensemble des acteurs, nous sommes prêts pour être source de proposition sur une solution d’accompagnement garantissant un résultat durable. Et là…The World is Your Oyster !
MMAPPER Insight

Déconnecter pour connecter
Il y a 10 ans déjà Richard et Pierre Paineau, alors Directeur de l’usine de Fenwick Linde de Cenon dans la Vienne, mettaient en place des journées de connexion avec l’ensemble des managers. Ces journées, Pierre les appelait journées ON plutôt que journées OFF…
Depuis nous avons réussi à insuffler cette pratique auprès de nombreuses d’équipes – une sorte d’hygiène de vie collective que de plus en plus de participants considèrent comme indispensables. Ces journées, souvent riches en émotions, permettent de se reconnecter humainement et de faire émerger l’intelligence collective. Car comme le dit notre ami Jérôme Lefeuvre « Nos émotions ne sont pas le problème. Elles sont la solution. »
Des journées de connexion, concrètement, à quoi ça sert ?
- A intégrer avec soin les nouveaux arrivants dans une équipe
- A prendre de la hauteur, partager la vision et le projet de l’équipe, et les faire évoluer
- A travailler ensemble sur des sujets importants qui demandent de la réflexion, comme par exemple définir un cadre de délégation
- Mettre sur la table « les trucs qui grattent » et apprendre à se dire les choses de façon entendable et constructive.
Avec MMAPPER, déconnectez pour reconnecter et prenez le temps d’en gagner ! 😉
La compréhension orale…Au secours !
Je ne comprends rien ! Ils parlent trop vite, ils ont un accent à couper au couteau, ils mangent la moitié des mots, ils n’arrêtent pas de changer de sujet…
Ça résonne ?
Et si vous essayiez de mieux ENTENDRE avant de chercher à COMPRENDRE ?
Considérons l’oreille comme un outil… Apprendre à s’en servir pour développer des techniques d’écoute plus efficaces, plus naturelles, moins énergivores serait chouette, n’est-ce pas ?
Chez ImpaQt, dans le pilier METHODE de MMAPPER, nous avons développé un processus pour accompagner nos apprenants dans cette quête :
Phase 1 : ECHAUFFEMENT – Préparez votre oreille à mieux entendre. Laissez-vous bercer, ne vous posez pas de question précise, entendez tout… Une écoute détendue permet de mieux saisir l’ensemble. J’ai d’ailleurs entendu dire que la musique classique est reconnue pour « l’ouverture » de l’oreille.
Phase 2 : SENSORIEL – Qu’est-ce que vous avez entendu et à quel moment ? Voix, bruits de fond, respiration, silences, répétitions. Sensibilisez votre oreille aux « sons » et à la structure musicale.
Phase 3 : PERCEPTION – Appuyez-vous sur votre expérience, votre logique, votre imagination, votre créativité et émettez quelques hypothèses.
Phase 4 : CONTEXTE – Que savez-vous à ce stade ? Qui /Quand /Où /Pourquoi /Comment ?
L’objectif étant de développer une écoute plus naturelle, un travail régulier dans la durée est clé pour un résultat solide.
Chaque étape apporte au résultat final. Ecoutez l’ensemble avant de vous lancez dans le détail.
Commencez par ce que vous savez déjà et économisez votre énergie pour la déployer là où vous en avez le plus besoin
Alors, c’est parti ?
Ouvrez grand vos oreilles !
MMAPPER Insight

Coming soon : Learning to Listen online!
Quel plaisir de me replonger dans le CD-Rom ‘Learning to Listen’ que j’ai créé en 2003 et cette fois-ci avec l’aide de Jean-Marc Dollinger, Thomas Delafosse et l’équipe d’experts en pédagogie d’ImpaQt !
L’objectif : le mettre au goût du jour et créer un outil d’apprentissage linguistique online.
Je suis fier de voir qu’il fait toujours sens, et qu’il est encore d’une grande utilité et innovant.
La réflexion sur le comment apprendre est souvent occultée pour passer directement au faire et à l’action ; nous constatons que la plupart des apprenants qui apprennent une langue écoutent la langue cible sans savoir pourquoi où comment. C’est là que ‘Learning to listen’ entre en jeu.
L’art de la performance
Quand nous prenons des cours de chant, de théâtre, de musique, de danse… le spectacle de fin permet de mettre en lumière tout le travail personnel et collectif et de partager un message, une histoire, une émotion avec l’auditoire. Tout doit être coordonné de manière cohérente et fluide avec une capacité à gérer des imprévus pour arriver au résultat escompté.
Les applaudissements indiquent la réussite de l’objectif et permettent de la savourer, et les critiques – à condition qu’elles soient bienveillantes, lucides et constructives – de se focaliser sur les axes d’amélioration.
Chez ImpaQt nous avons la même approche.
La réussite de la communication d’un message comporte une multitude d’éléments : le rythme, l’intonation, la prononciation, le choix des mots, la spontanéité, la projection de la voix, les aspects paralinguistiques… Tous ces éléments sont travaillés individuellement et collectivement pendant les sessions tout au long de la formation. La performance est l’occasion de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour obtenir un résultat global efficace.
C’est également l’occasion de mettre en pratique ses acquis dans une situation réelle (ACTEUR), de tester son savoir et son savoir-faire en anglais dans un contexte de communication interactif (RISQUE) et de faire un benchmarking grâce aux regards croisés de l’auditoire.
L’objectif de communication professionnelle est-il atteint ? (PROJET)
L’apprenant est-il satisfait, fier de sa performance ? (PLAISIR)
Est-ce que le travail fourni a payé ? (EFFORT)
Que serait-il judicieux d’améliorer ? (MIROIR)
Et comment pourrait-il s’y prendre ? (METHODE)
Le rideau se lève avec MMAPPER !
MMAPPER Insight
Effective Communication ou Pitch Up ? Que Choisir ?
Les points communs :
- Le pré-requis : avoir un niveau minimum B2 où la langue n’est plus une barrière.
- Des programmes collectifs intra ou interentreprises.
- Un challenge à la clé : une mise en situation professionnelle hors de sa zone de confort pour Effective Communication, une présentation en public pour Pitch Up.
- MMAPPER comme outil de positionnement et de définition d’objectifs personnalisés.
Les différences :
- Les domaines de compétence :
Langues pour Effective Communication : la dernière étape de notre parcours de développement linguistique en langue anglaise qui permet d’évoluer d’un niveau B2 vers un niveau C1.
Communication pour Pitch-Up : un programme de prise de parole en public en anglais.
- Les besoins :
Effective Communication : affiner ses compétences linguistiques en langue anglaise, nuancer ses messages et gagner en agilité. Gérer des situations de communication « complexes » et des échanges avec des natifs.
Pitch Up : booster ses “presentation skills” en contexte international. Faire un pitch ou une présentation impactante en anglais.
- Le public cible :
Effective Communication : Des personnes qui ont une utilisation quasi quotidienne de l’anglais et sont amenées à gérer des situations de communication complexes et/ou des contacts avec des natifs.
Pitch Up : Des personnes qui ont besoin d’améliorer leurs « presentation skills » et de faire des présentations en anglais en contexte international.
- La durée :
Effective Communication : un programme de 8 journées.
Pitch Up : un programme de 3 journées.
MMAPPER Insight
Notre projet d’application MMAPPER avance !
Au cours du 3ème trimestre 2023, Richard & Géraldine ont travaillé à l’élaboration de questions clés qui permettront à un individu de se positionner. Et ils ont intégré la notion de questions « bonus » qui permettront à chacun d’être acteur de son positionnement en fonction de sa réalité du moment.
Contrairement à ce questionnaire inédit, les outils de positionnement existants proposent une “photo” de soi dont le danger est qu’elle soit perçue comme une vérité immuable.
Or pour nous un travail de connaissance de soi est un voyage dans la durée. Et la seule personne qui au bout du compte peut se positionner est la personne elle-même, en prenant en compte une diversité de regard sur elle-même.
Ceci représente un changement total de prisme, une approche “pathfinder” où les pions peuvent bouger au fur et à mesure de l’avancement de la réflexion.
Bref, notre projet d’application de positionnement avance bien et le cheminement est passionnant.
Et nous serons bientôt prêts à lancer une phase de pré-test pour tester le fond afin de pouvoir soumettre un cahier des charges solide à des experts de la programmation.
Vous êtes intéressés pour participer à cette phase de pré-test ?
MMAPPER Insight
Une nouveau Lifelong Learning File est en train de voir le jour !
La version actuelle date de 2015. Il était grand temps d’en créer une nouvelle !
Au fait, qu’est-ce c’est ? Et surtout, à quoi ça sert ?
Un Lifelong Learning File est un outil d’apprentissage tout au long de la vie, personnalisable, qui sert à structurer son apprentissage autour de son projet, qu’il soit individuel ou collectif.
Le modèle MMAPPER étant issu de notre réflexion sur les clés d’un apprentissage réussi, structurer cette nouvelle version par piliers du modèle nous est apparu comme une évidence.
Le Lifelong Learning File permet d’abord de garder trace de son cheminement. Dans la culture qui est la nôtre, celle du « lifelong learning », l’apprenant(e) est amené(e) à définir son projet après s’être positionné, au début puis tout au long du processus. Ce suivi dans la durée permet de garder le cap et de visualiser ses progrès et le chemin parcouru.
Ainsi nos apprenants y trouveront des documents permettant de se positionner et de formaliser leur projet ainsi que les objectifs et actions associés.
Tout autre contenu qu’ils choisiront d’intégrer y trouveront naturellement leur place une fois les objectifs définis.
Les documents clefs seront disponibles en version digitale.
Il sera prêt au 1er janvier 2024 et ressemblera à ça :
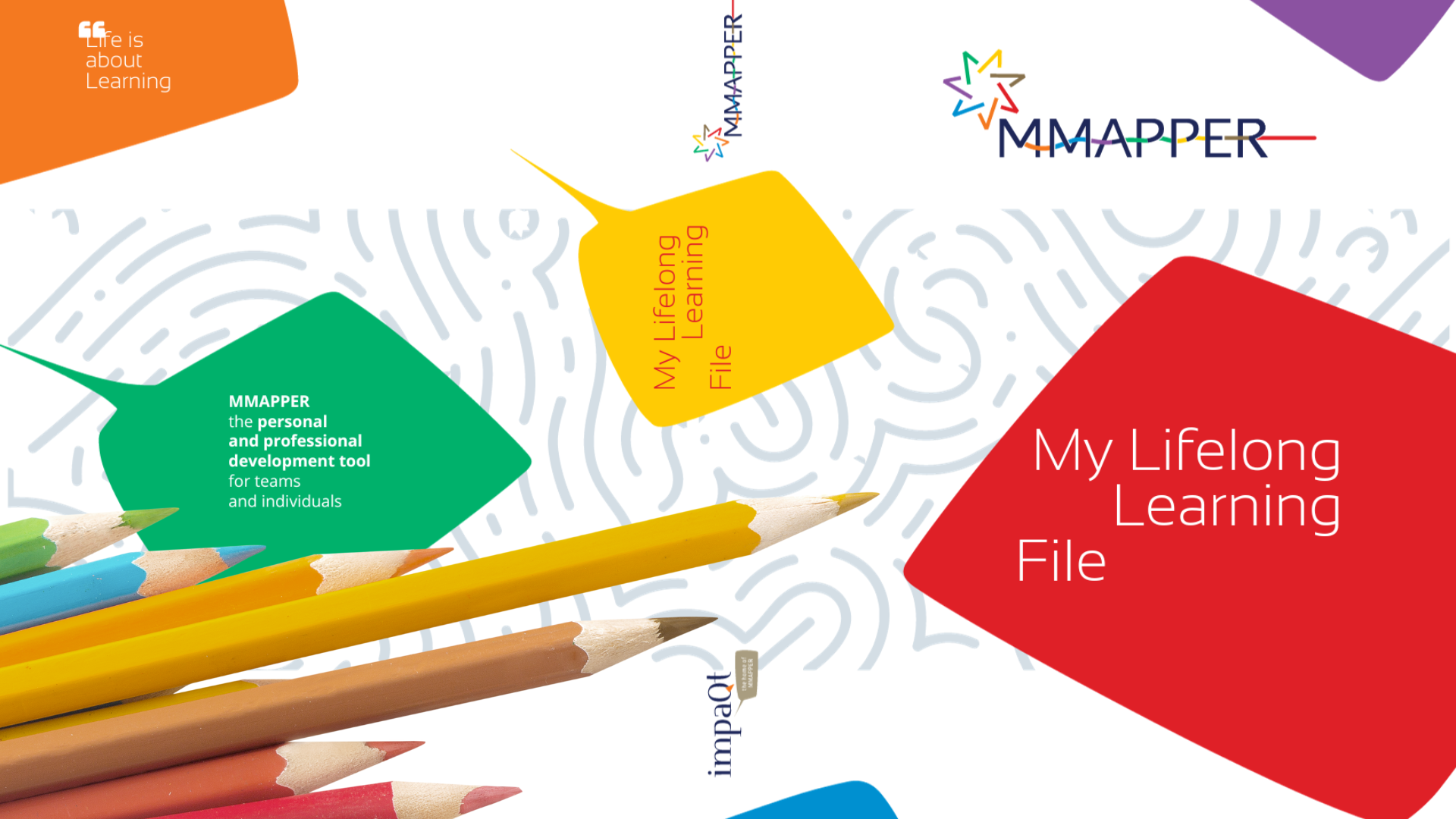
« Si tu diffères de moi, mon frère,
loin de me léser, tu m’enrichis. »